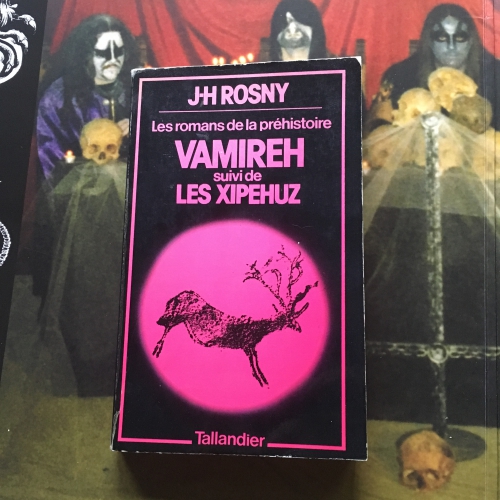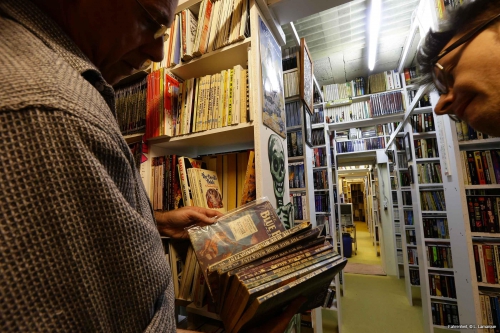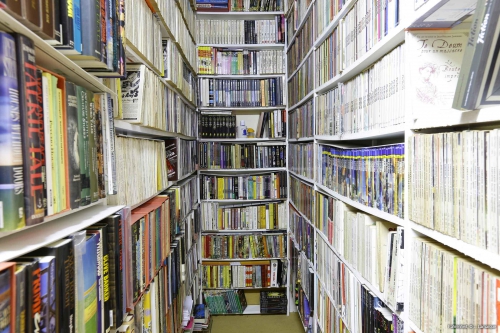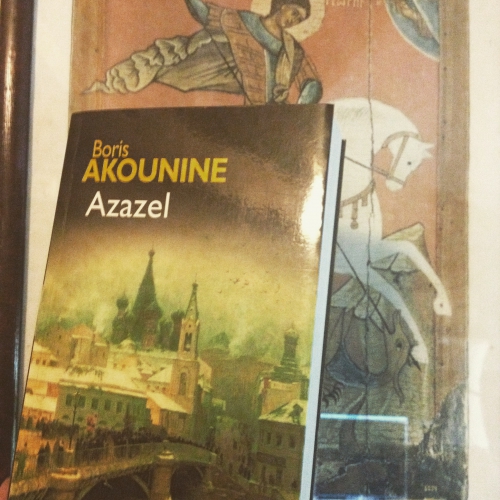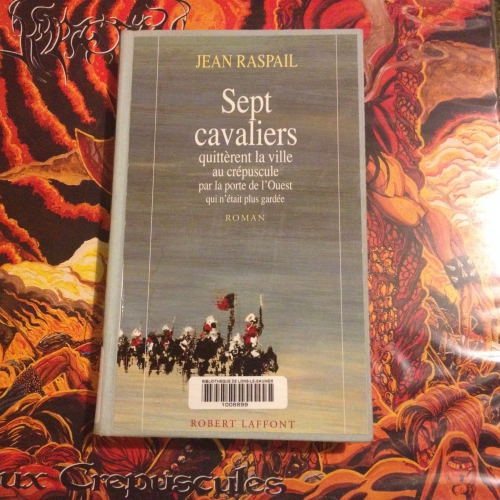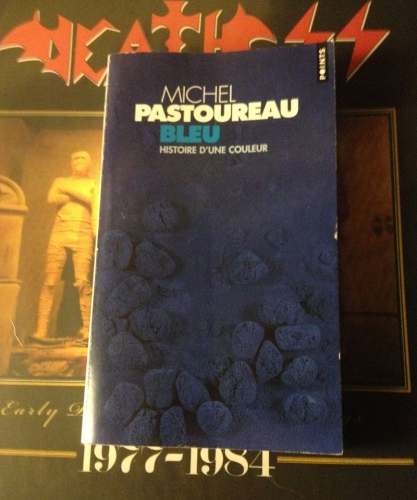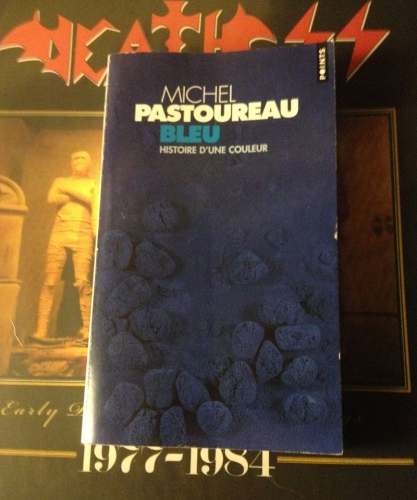
Comment un truc aussi anodin que la couleur bleue peut donner lieu à une étude, un bouquin ? Ca peut sembler un peu idiot, comme ça, et pourtant...
Et pourtant, pour qui a un peu l'esprit ouvert, voilà un vrai sujet, et une enquête passionnante signée Pastoureau, qui s'est déjà occupé d'Histoire, d'armoiries, de cochon et d'ours.
On apprend donc des choses assez incroyables sur l'histoire de la couleur bleue, mais également sur d'autres choses, par extrapolation.
Historiquement, le bleu a été "découvert" assez tard. Dans les peuplades civilisées (ici l'auteur ne traite grosso modo que de l'Histoire européenne. Si vous voulez savoir comment les Papous traitent cette couleur, allez vous faire enc...), le bleu n'était pas une couleur en soit. Le ciel bleu ? Bof, tout au plus, une nuance de gris. Le bleu a été associé aux barbares, du style Mel Gibson qui s'en tartinait la tronche, ou les Germains, chez qui on trouvait la guède à l'origine des premières teintes. Mais pour les Romains, le bleu était une couleur avilissante. Chez eux, un roux crépu aux yeux bleus était le sommet de la laideur et du dédain... la couleur était également assez difficile à créer, à partir de la guède d'Europe, ou du lazward (azur) perse, lui-même plus long à importer. La technique de fixation, voilà un facteur de retardement pour le développement de cette couleur. Bien des siècles plus tard, un des autres freins à son développement est simplement... la concurrence. Au Moyen-Age (que les thuriféraires de la modernité nous dépeignent comme une époque sombre et crasseuse, pleine d'obscurantisme, et de verrues, tout le contraire de notre belle époque où TOUT VA BIEN, quoi, hein) les teinturiers se tiraient déjà la bourre, grosses industries, pour se partager le marché. Et les plus forts, c'étaient les teinturiers de... rouge ! Le rouge, qui avait la faveur d'alors. Ils usaient de pressions pour que le bleu ne se développe pas trop.
C'est d'ailleurs à ce moment du livre où l'on se rend compte d'un autre élément intéressant. Ces pouilleux moyen-ageux, nauséabonds et rances, étaient déjà... écologistes ! Car oui, dans les villes, il y avait deux corps de métier qui se côtoyaient : les teinturiers, et les tanneurs. Ils se partageaient les eaux de la rivière, avec un système d'entente, car quand l'un polluait en amont, l'autre en aval se prenait toute la merde. Les autorités de l'époque ont d'ailleurs fixé des règles d'instauration de ces industries en banlieue de la ville, pour ne pas incommoder les habitants par cette pollution. Un obscurantisme, on vous dit.
De retour à notre bleu, le terme "bleu" vient du latin "blavus", qui n'évoque pas vraiment les vacances à la plage. Le terme est lié au gris, au blême, au blafard (blafard vient de blavus). Les Germains ont repris le terme pour "blau", ce qui a donné "bleu" chez nous, le terme azur ne prenant sa place que dans le sud de l'Europe, comme l'Espagne et peut-être l'occitan, mais je n'ai pas trouvé de traduction.
Or, pendant très longtemps, la gamme chromatique est restée sur trois couleurs : blanc, rouge et noir. Ces couleurs ont été utilisées largement et symboliquement, avec parfois des changements de sens. Liturgiquement, le blanc représentait la pureté et l'innocence, le noir l'abstinence, la pénitence et l'affliction, et le rouge le sang versé, la Passion, le martyre, le sacrifice.
C'est ainsi que le noir est devenu la couleur des moines qui sont dans la pénitence, mais également, c'était la couleur attribuée à Marie à un moment. D'où mon extrapolation personnelle (peut-être totalement fausse, mais bon, je me lance) : l'origine de la Vierge noire vient peut-être de la symbolique liée à la pénitence de la Vierge, plutôt qu'à sa "pureté" (bien qu'on trouve plus tard la Vierge en blanc, avec une écharpe bleue - qui je crois n'a rien à voir avec le Tour de France). Et on peut penser qu'il est plus simple de travailler un matériau naturellement coloré que teint manuellement, aussi l'idée symbolique de représenter la Vierge était de le faire avec un matériau de la couleur de la pénitence, soit un bois noir par exemple. Plus tard, la couleur symbolique changeant (soit par effet de mode, soit par lobbying), on change de couleur pour représenter le divin. D'ailleurs, au début l'or était très présent comme couleur dans les peintures, sculptures, cela a changé avec la démocratisation de la couleur bleue (et de l'or comme richesse passant dans les poches des bures des prélats, en même temps que leur pouvoir politique grandissait).
Egalement, on apprend que la teinture bleue était à l'origine assez pâle, et les techniques de transformation ont évolué, mais ont stagné pendant une bonne période. Là pour le coup, y a de l'obscurantisme : pour obtenir la couleur, il fallait procéder à des mélanges, des opérations de transformation. Or, ce n'est pas quelque chose de naturel, cela ne procède pas de la Création, mais de la main de l'Homme. Et pendant un bon moment, ça a été considéré comme... sorcellerie. Le métier de teinturier a donc fait partie de ces métiers exécrés, comme les médecins, chimistes, qui se prenaient pas pour de la merde et défiaient Dieu à faire les malins et créer ce que Dieu n'avait pas créé. Et comme Dieu c'est le boss, qui sait tout mieux que les autres, s'il a pas fait quelque chose, c'est qu'il y a une raison. C'est pas bien. Un peu comme le nucléaire, quoi. C'est satanique.
L'époque n'était pas très propice aux interrogations de la science. D'un autre côté, des documents ont été conservés sur les opérations pour fixer la couleur. Des documents dont Pastoureau s'étonne de la valeur, puisque le métier s'apprenait surtout de bouche à oreille, il semble qu'il y avait alors déjà une administration tatillonne qui demandait des comptes...
Ces documents sont parfois farfelus. Par exemple, il est dit de plonger le tissu dans un bain pendant une durée, soit de trois jours, soit de neuf mois. Pastoureau nous explique qu'en fait, à l'époque, ce qui est important, ce n'est pas forcément le détail, mais le rituel. Car oui, trois jours, c'est la durée entre la mort et la résurrection de Jésus, et neuf mois, c'est la durée de maternité. Il ne faut donc pas s'attacher trop à la durée en tant que telle, mais au symbole. Ici, ça peut vouloir dire "plonger le tissu dans le bain jusqu'à ce qu'apparaisse quelque chose". Des bulles, une décoloration, je ne sais pas, mais un changement.
L'histoire de la couleur bleue évolue jusqu'à ce que cette couleur soit utilisée et démocratisée, sortant de son confinement, et jusqu'à aujourd'hui, omniprésente.
On remarquera que les Protestants ont utilisé le bleu avec le noir, le blanc et le gris, bannissant les autres couleurs chatoyantes, dans leur délire prude et bigot. Pas étonnant d'ailleurs que le blue jean soit le vêtement le plus populaire chez les Anglo-Saxons.
L'auteur passe également du temps à parler des couleurs qui ont amené le drapeau français, qui pourraient être tout de même intrinsèquement liées aux couleurs des USA et de l'Angleterre... puisque la révolution française aurait pu prendre comme modèle les couleurs de la révolution américaine qui elle-même reprenait les couleurs de l'Union Jack, dans une sorte de pied-de-nez à la Couronne...
Un ouvrage assez court, mais passionnant, et qui ouvre beaucoup de portes donc. Intéressez-vous aux peintures, rupestres, mosaïques romaines, peintures médiévales, flamandes, et contemporaines pour y déceler l'utilisation ou pas du bleu... C'est véritablement quelque chose qui devrait sauter aux yeux, et pourtant... maintenant que vous êtes sensibilisés, faites y attention. Et profitez en pour déceler les anachronismes que le cinéma pourrait nous apporter !